5. La Commune combattante
Entre
la dictature et l’anarchie
Mais la Commune gouverna dans le
désordre, oscillant sans cesse entre la dictature et l’anarchie.
Les responsables des diverses commissions chargées des services
ministériels changèrent à plusieurs reprises, en ce
qui concerne particulièrement les affaires militaires. Comme la
situation s’aggravait, les « jacobins » de la Commune firent
voter, par 45 voix contre 23, la formation d’un Comité de salut
public, dont l’intervention dans les affaires de la guerre fut particulièrement
malheureuse. Renouvelé, avec l’appui de la minorité cette
fois, après la démission du délégué
à la guerre Rossel, le nouveau Comité de salut public prit
quelques mesures salutaires, mais trop tardives. La lutte entre majorité
et minorité, les rivalités de personnes minaient la Commune
de l’intérieur ; à l’extérieur, l’ingérence
continuelle du Comité central de la garde nationale dans les affaires
militaires paralysait son pouvoir. La prolifération anarchique de
comités divers, qui soutenaient la révolution, l’affaiblissait
en même temps, en particulier en ce qui concerne la défense
de la Commune. La Commune se méfiait des militaires qu’elle avait
délégués à la guerre : de l’aventurier Cluseret
aussi bien que du généreux Rossel. Les gardes nationaux les
plus ardents étaient des combattants révolutionnaires, qui
répugnaient à une discipline nécessaire. Enfin, des
tentatives de conciliation de la part de l’Union des chambres syndicales,
de l’Union républicaine des droits de Paris, des députés
de Paris, des membres de la franc-maçonnerie, alors qu’il ne pouvait
y avoir de conciliation entre la Commune et Versailles, n’eurent pour effet
que d’amoindrir la résistance de Paris.
Une
lutte inégale
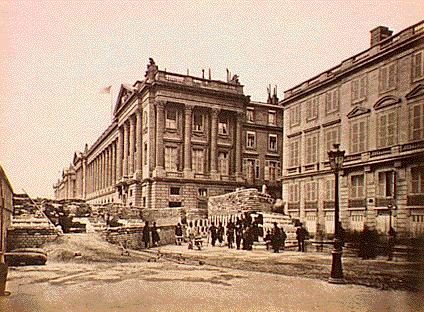 Paris
n’eut jamais plus de 40 000 combattants, auxquels il faut ajouter des femmes
et des adolescents. Thiers, au contraire, avait, avec l’appui de Bismarck,
reformé son armée : elle comptait 63 500 hommes, auxquels
s’ajoutèrent 130 000 prisonniers libérés d’Allemagne.
Jusqu’aux élections de la Commune, il n’y a guère que quelques
escarmouches. Mais, le 30 mars, les fédérés sont délogés
du rond-point de Courbevoie. Le 2 et le 3 avril, les fédérés
essayent de prendre l’offensive. Flourens et Duval sont exécutés
par les « versaillais ». À ces exécutions de
prisonniers, la Commune répond par le « décret des
otages », qui d’ailleurs ne sera pas appliqué. Du 11 avril
au 21 mai, la lutte se poursuit autour de Paris. Le général
de la Commune, Dombrowski, inflige aux versaillais des pertes importantes.
Mais, après une courte trêve qui permet aux habitants de quitter
Neuilly en ruines, les versaillais reprennent leurs attaques. Les forts
du Sud sont intensément bombardés. Le fort d’Issy, abandonné
un moment, est repris par les fédérés. C’est alors
que la Commune remplace Cluseret par Rossel (30 avril), qui essaie en vain
de réorganiser l’armée fédérée. À
partir du 1er mai commence le bombardement systématique de Paris
par l’armée versaillaise. Dans la nuit du 3 au 4 mai, la redoute
du Moulin-Saquet tombe, puis, le 8, le fort d’Issy, qui n’est plus qu’une
ruine. Las, dégoûté, Rossel donne sa démission
de délégué à la Guerre ; il est remplacé
par un délégué civil, le vieux jacobin Delescluze.
Le 13, le fort de Vanves tombe à son tour. Passy, Grenelle, Auteuil,
la Muette croulent sous les obus versaillais.
Paris
n’eut jamais plus de 40 000 combattants, auxquels il faut ajouter des femmes
et des adolescents. Thiers, au contraire, avait, avec l’appui de Bismarck,
reformé son armée : elle comptait 63 500 hommes, auxquels
s’ajoutèrent 130 000 prisonniers libérés d’Allemagne.
Jusqu’aux élections de la Commune, il n’y a guère que quelques
escarmouches. Mais, le 30 mars, les fédérés sont délogés
du rond-point de Courbevoie. Le 2 et le 3 avril, les fédérés
essayent de prendre l’offensive. Flourens et Duval sont exécutés
par les « versaillais ». À ces exécutions de
prisonniers, la Commune répond par le « décret des
otages », qui d’ailleurs ne sera pas appliqué. Du 11 avril
au 21 mai, la lutte se poursuit autour de Paris. Le général
de la Commune, Dombrowski, inflige aux versaillais des pertes importantes.
Mais, après une courte trêve qui permet aux habitants de quitter
Neuilly en ruines, les versaillais reprennent leurs attaques. Les forts
du Sud sont intensément bombardés. Le fort d’Issy, abandonné
un moment, est repris par les fédérés. C’est alors
que la Commune remplace Cluseret par Rossel (30 avril), qui essaie en vain
de réorganiser l’armée fédérée. À
partir du 1er mai commence le bombardement systématique de Paris
par l’armée versaillaise. Dans la nuit du 3 au 4 mai, la redoute
du Moulin-Saquet tombe, puis, le 8, le fort d’Issy, qui n’est plus qu’une
ruine. Las, dégoûté, Rossel donne sa démission
de délégué à la Guerre ; il est remplacé
par un délégué civil, le vieux jacobin Delescluze.
Le 13, le fort de Vanves tombe à son tour. Passy, Grenelle, Auteuil,
la Muette croulent sous les obus versaillais.
L’énergie
du désespoir
Le dimanche 21 mai, les troupes
gouvernementales entrent dans Paris par la porte de Saint-Cloud. Pendant
une semaine, les combattants de la Commune luttent quartier par quartier,
maison par maison, barricade par barricade. Les versaillais fusillent tous
ceux qu’ils prennent les armes à la main ; les premières
exécutions massives ont lieu à la caserne de la rue de Babylone,
tandis que les pompiers de la Commune éteignent l’incendie du ministère
des Finances, allumé par des obus versaillais. Il convient de faire
le point sur ces incendies de Paris, que l’on a tant reprochés aux
communards. En premier lieu, les obus de Thiers avaient déjà
endommagé les quartiers de l’Ouest. D’autre part, certains incendies
peuvent être attribués à des agents bonapartistes,
qui avaient intérêt à faire disparaître des traces
de la gestion impériale. Enfin, les incendies allumés par
les communards au cours des combats doivent être assimilés
à des actes de guerre : ce furent des moyens militaires de s’opposer
à l’avance de l’ennemi. La Légion d’honneur, la Cour des
comptes, le Conseil d’État ont été ainsi la proie
des flammes. Si les communards mettent le feu à la Préfecture
de police et à une partie du Palais de justice, des mesures sont
prises pour sauvegarder la Sainte-Chapelle et Notre-Dame. Aux massacres
des habitants de Paris par les troupes régulières, la Commune
répond en faisant exécuter cinquante-deux otages, dont l’archevêque
de Paris, Mgr Darboy. Le 26 mai, la résistance est à son
comble, tandis que les exécutions sommaires par les versaillais
se multiplient à mesure qu’ils avancent dans Paris. Le 27 mai, c’est
le massacre des fédérés au milieu des tombes du Père-Lachaise.
Cependant, le 28, Ferré, Varlin, Gambon se battent encore au cœur
du Paris populaire, entre la rue du Faubourg-du-Temple et le boulevard
de Belleville. À une heure, la dernière barricade tombe.
Le lendemain, le fort de Vincennes capitule et ses neuf officiers sont
fusillés sur-le-champ.
Un
fleuve de sang
Les jours suivants, les cours martiales
continuèrent à condamner à mort. Il suffisait qu’une
femme fût pauvre et mal vêtue pour être exécutée
comme « pétroleuse ». La Seine était devenue
un fleuve de sang.  Le
9 juin, Paris-Journal écrivait encore : « C’est au bois
de Boulogne que seront exécutés à l’avenir les gens
condamnés à la peine de mort par la cour martiale. Toutes
les fois que le nombre des condamnés dépassera dix hommes,
on remplacera par une mitrailleuse le peloton d’exécution. »
L’« armée de l’ordre » avait perdu 877 hommes depuis
le début d’avril. Mais on ne sait exactement combien d’hommes, de
femmes et d’enfants furent massacrés au cours des combats ou sur
l’ordre des cours martiales. On peut sans doute avancer le chiffre de trente
mille victimes.
Le
9 juin, Paris-Journal écrivait encore : « C’est au bois
de Boulogne que seront exécutés à l’avenir les gens
condamnés à la peine de mort par la cour martiale. Toutes
les fois que le nombre des condamnés dépassera dix hommes,
on remplacera par une mitrailleuse le peloton d’exécution. »
L’« armée de l’ordre » avait perdu 877 hommes depuis
le début d’avril. Mais on ne sait exactement combien d’hommes, de
femmes et d’enfants furent massacrés au cours des combats ou sur
l’ordre des cours martiales. On peut sans doute avancer le chiffre de trente
mille victimes.
À Versailles, on avait entassé
plus de trente-huit mille prisonniers. On en envoya aussi dans des forts
et sur des pontons. Beaucoup moururent de mauvais traitements. Pour juger
les vaincus de la Commune, quatre conseils de guerre fonctionnèrent
jusqu’en 1874. Il y eut 10 042 condamnations et 3 761 condamnations par
contumace. Ferré, Rossel se montrèrent devant les conseils
de guerre à la hauteur de leur destin. Ils furent condamnés
à mort et fusillés. Le plus grand nombre fut déporté
en Nouvelle-Calédonie ou en Guyane. D’autres réussirent à
gagner la Belgique, la Suisse et l’Angleterre. L’amnistie, votée
en 1880, ramena en France les derniers survivants.
Les
leçons de la Commune
Certes, la Commune a commis de lourdes
fautes. Elle n’a pu ni organiser sa défense, ni lier son action
à celle de la province et de la paysannerie. Sans doute les conditions
économiques n’étaient-elles pas mûres encore pour instaurer
sur des bases socialistes la nouvelle société qu’elle entrevoyait.
Mais, par les décisions prises pour l’organisation du travail (suppression
du travail de nuit pour les ouvriers boulangers, suppression des amendes
et retenues sur les salaires, réouverture et gestion des ateliers
par des coopératives ouvrières) et par diverses mesures sociales,
la Commune a tracé la voie à une société qui
ne serait plus gérée au profit du capitalisme, dans l’intérêt
de la bourgeoisie, mais qui déboucherait sur le socialisme. C’est
donc à partir de faits très réels que Karl Marx, le
premier, a pu écrire : « Le Paris ouvrier, avec sa Commune,
sera célébré à jamais comme le glorieux fourrier
d’une société nouvelle. Ses martyrs seront enclos dans le
grand cœur de la classe ouvrière. » Cependant, la Commune
fut en majorité un gouvernement de petits-bourgeois et l’on ne saurait
y trouver en germe l’idée de la dictature du prolétariat,
ni même l’organisation d’un parti directeur de la classe ouvrière.
Anarchistes, communistes, socialistes de diverses obédiences peuvent
donc à la fois se réclamer de son expérience et en
dégager, par-delà l’histoire et sans la fausser, la force
élémentaire d’un mythe révolutionnaire et un espoir
: celui d’une société sans classes, où régnerait
la justice sociale.
Retour sommaire
Retour au plan de la
Commune
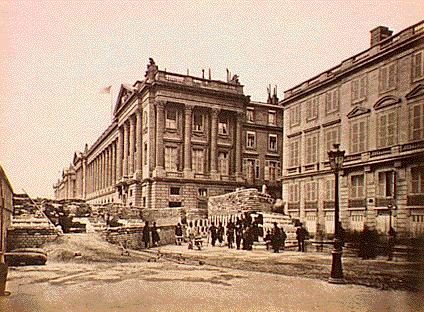 Paris
n’eut jamais plus de 40 000 combattants, auxquels il faut ajouter des femmes
et des adolescents. Thiers, au contraire, avait, avec l’appui de Bismarck,
reformé son armée : elle comptait 63 500 hommes, auxquels
s’ajoutèrent 130 000 prisonniers libérés d’Allemagne.
Jusqu’aux élections de la Commune, il n’y a guère que quelques
escarmouches. Mais, le 30 mars, les fédérés sont délogés
du rond-point de Courbevoie. Le 2 et le 3 avril, les fédérés
essayent de prendre l’offensive. Flourens et Duval sont exécutés
par les « versaillais ». À ces exécutions de
prisonniers, la Commune répond par le « décret des
otages », qui d’ailleurs ne sera pas appliqué. Du 11 avril
au 21 mai, la lutte se poursuit autour de Paris. Le général
de la Commune, Dombrowski, inflige aux versaillais des pertes importantes.
Mais, après une courte trêve qui permet aux habitants de quitter
Neuilly en ruines, les versaillais reprennent leurs attaques. Les forts
du Sud sont intensément bombardés. Le fort d’Issy, abandonné
un moment, est repris par les fédérés. C’est alors
que la Commune remplace Cluseret par Rossel (30 avril), qui essaie en vain
de réorganiser l’armée fédérée. À
partir du 1er mai commence le bombardement systématique de Paris
par l’armée versaillaise. Dans la nuit du 3 au 4 mai, la redoute
du Moulin-Saquet tombe, puis, le 8, le fort d’Issy, qui n’est plus qu’une
ruine. Las, dégoûté, Rossel donne sa démission
de délégué à la Guerre ; il est remplacé
par un délégué civil, le vieux jacobin Delescluze.
Le 13, le fort de Vanves tombe à son tour. Passy, Grenelle, Auteuil,
la Muette croulent sous les obus versaillais.
Paris
n’eut jamais plus de 40 000 combattants, auxquels il faut ajouter des femmes
et des adolescents. Thiers, au contraire, avait, avec l’appui de Bismarck,
reformé son armée : elle comptait 63 500 hommes, auxquels
s’ajoutèrent 130 000 prisonniers libérés d’Allemagne.
Jusqu’aux élections de la Commune, il n’y a guère que quelques
escarmouches. Mais, le 30 mars, les fédérés sont délogés
du rond-point de Courbevoie. Le 2 et le 3 avril, les fédérés
essayent de prendre l’offensive. Flourens et Duval sont exécutés
par les « versaillais ». À ces exécutions de
prisonniers, la Commune répond par le « décret des
otages », qui d’ailleurs ne sera pas appliqué. Du 11 avril
au 21 mai, la lutte se poursuit autour de Paris. Le général
de la Commune, Dombrowski, inflige aux versaillais des pertes importantes.
Mais, après une courte trêve qui permet aux habitants de quitter
Neuilly en ruines, les versaillais reprennent leurs attaques. Les forts
du Sud sont intensément bombardés. Le fort d’Issy, abandonné
un moment, est repris par les fédérés. C’est alors
que la Commune remplace Cluseret par Rossel (30 avril), qui essaie en vain
de réorganiser l’armée fédérée. À
partir du 1er mai commence le bombardement systématique de Paris
par l’armée versaillaise. Dans la nuit du 3 au 4 mai, la redoute
du Moulin-Saquet tombe, puis, le 8, le fort d’Issy, qui n’est plus qu’une
ruine. Las, dégoûté, Rossel donne sa démission
de délégué à la Guerre ; il est remplacé
par un délégué civil, le vieux jacobin Delescluze.
Le 13, le fort de Vanves tombe à son tour. Passy, Grenelle, Auteuil,
la Muette croulent sous les obus versaillais.
 Le
9 juin, Paris-Journal écrivait encore : « C’est au bois
de Boulogne que seront exécutés à l’avenir les gens
condamnés à la peine de mort par la cour martiale. Toutes
les fois que le nombre des condamnés dépassera dix hommes,
on remplacera par une mitrailleuse le peloton d’exécution. »
L’« armée de l’ordre » avait perdu 877 hommes depuis
le début d’avril. Mais on ne sait exactement combien d’hommes, de
femmes et d’enfants furent massacrés au cours des combats ou sur
l’ordre des cours martiales. On peut sans doute avancer le chiffre de trente
mille victimes.
Le
9 juin, Paris-Journal écrivait encore : « C’est au bois
de Boulogne que seront exécutés à l’avenir les gens
condamnés à la peine de mort par la cour martiale. Toutes
les fois que le nombre des condamnés dépassera dix hommes,
on remplacera par une mitrailleuse le peloton d’exécution. »
L’« armée de l’ordre » avait perdu 877 hommes depuis
le début d’avril. Mais on ne sait exactement combien d’hommes, de
femmes et d’enfants furent massacrés au cours des combats ou sur
l’ordre des cours martiales. On peut sans doute avancer le chiffre de trente
mille victimes.